S’il est beaucoup question d’offres de dessin en musées de beaux-arts, d’autres approches sont à imaginer : déambuler dans une exposition sur la faune africaine pour créer un carnet de voyage, s’initier au dessin de perspective dans un bâtiment industriel, tenter le pastel le temps d’une visite d’un village d’art et d’histoire, dessiner à l’encre un paysage romantique… Mais comment faire ? Exposcope vous livre quelques trucs et astuces.
Les acteurs du projet
Afin de proposer des moments de dessin dans un lieu patrimonial, on peut se tourner vers des acteurs aux profils variés. Pour les villes pourvues d’une école de beaux-arts ou de graphisme, on peut s’associer avec les professeurs et étudiants. De même, on peut se tourner vers des ateliers et des associations proposant des cours de dessin d’après modèle vivant. Je vous parlais par exemple dans mon précédent article de l’association Dr Sketchy, mais d’autres initiatives existent ailleurs. Des artistes plasticiens, illustrateurs jeunesse ou de BD, ainsi que des art-thérapeutes peuvent intervenir pour un événement ponctuel ou pour un cycle (comme Pascaline Bonnave au Palais des Beaux-Arts de Lille). L’intervenant et le type d’atelier dépendront du public-cible et des objectifs définis pour de la séance : découvrir une pratique, se réapproprier son image par l’autoportrait, découvrir la flore locale en créant son carnet d’observation…
On peut aussi créer et animer soi-même son propre atelier, en tant que médiateur. Je vous partagedans cet article mes observations faites sur le terrain, pour proposer de dessiner dans un livret-jeux, un livret d’élève, un dispositif présent dans une exposition, voire parfois un atelier de dessin pour les plus jeunes. Ces conseils ne remplacent en rien un cours avec un professeur de dessin et l’intervention d’un artiste, mais vous permettront d’être autonomes sur un certain nombre de points !
Anticiper l’inévitable « je ne sais pas dessiner »
Cette phrase est aussi décliné en « mon dessin est trop moche » ou « je sais pas faire » par les participants. Mais il n’existe pas qu’un seul style, chacun le sien ; et le dessin s’apprend et se perfectionne par l’entraînement, ça ne se fait pas en un jour mais avec de la persévérance. Plusieurs fois je me suis retrouvée face à des enfants perfectionnistes se mettant une pression folle, et j’en ai même vu fondre en larmes parce que leur dessin n’était pas assez bien pour eux. Dans ce cas, il est important de les aider mais sans dénaturer le dessin originel, et parfois écarter les parents pas toujours ouverts et bien souvent juges sévères à propos de ce qu’il « faut » faire. On peut prévoir des modèles à recopier pour se mettre en confiance, du calque pour reporter les grandes lignes sur sa feuille, ou une règle pour faire la mise au carreau en traçant un quadrillage sur le modèle.

Guider le dessinateur pour éviter la peur de la page blanche
Par où commencer ? Ce dilemme arrive souvent quand on est persuadé de ne pas savoir dessiner. On peut déjà commencer par choisir une feuille A5 comme support, plutôt qu’un grand A4 intimidant.
Ensuite, on peut proposer une amorce : points à relier pour les plus jeunes, base à décalquer, ou dessin déjà partiellement commencé. Le Muséum de Bordeaux présente ainsi dans un livret pour élèves le début d’une silhouette d’oiseau, à compléter soi-même. De même, le Petit Palais proposait des reproductions d’œuvres avec des éléments à compléter par des enfants, pour sa « Nuit du Dessin ». Cela permet dese concentrer sur un ou deux détails (bec et pattes, bras et jambes) sans devoir reproduire toute la silhouette, exercice plus difficile. La fabrique toi-même innove dans la pratique du dessin sans peur de la page blanche, avec des ateliers pour se décalquer le portrait … mais ça, on en reparlera dans le prochain article 😉

On peut encore guider le dessinateur en décomposant les étapes, par des exercices simples, modèle à l’appui. Les livres jeunesse J’apprends à dessiner partent de formes bien connues (rond, carré, triangle), pour créer un dessin en 4 étapes seulement. Ces livres couvrent de nombreux thèmes : animaux, mythologie, moyens de transport, châteaux forts, avions, sportifs, cirque, fleurs, préhistoire… J’ai adapté cette méthode pour un atelier avec des 6-12 ans, en partant de l’alphabet majuscule en caractères d’imprimerie pour arriver à une calligraphie caroline adaptée. Passé 6/7 ans, un enfant connaît généralement bien ces « lettres bâton », que l’on retravaille ensuite ensemble avec un modèle au crayon, pour se rapprocher de formes obtenues habituellement au calame ou à la plume d’oie.

Pas touche à mon dessin !
Même si on vous dit « je ne sais pas dessiner », ne JAMAIS toucher au dessin d’un autre !! Tout dessinateur, débutant ou non, déteste ça. J’ai parfois vu des parents voulant gentiment reprendre le dessin des enfants pour que ce soit plus joli, et les enfants s’y opposaient farouchement. Pour aider à corriger (si on vous demande de l’aide uniquement !), il faut plutôt le faire sur un brouillon, ou dans la marge. Et ne le faire que si cela répond à un objectif particulier de l’atelier (maîtriser les proportions par exemple) ou que si on nous demande de l’aide, mais ne portons pas de jugement de valeur sur la création d’autrui. Restons bienveillants et mettons les dessinateurs en confiance 🙂
Le matériel du dessinateur
Pour dessiner à l’aise, mieux vaut avoir le droit de s’assoir (par terre ou sur des sièges), mais aussi avoir le bon matériel. Ensuite, un support rigide sera nécessaire, idéalement un porte-bloc ou une table.
Question médium, l’idéal pour débuter est un criterium ou un crayon à papier bien taillé. On peut choisir un crayon HB uniquement, ou une gamme du 4H au 8B par exemple. Mon conseil : évitez les crayons à papier Bic Évolution qui marquent trop le papier. Pour des raisons de conservation, les musées interdisent parfois les gommes classiques qui font des miettes. Heureusement, la gomme « mie de pain » ne laisse pas de peluches et abîme moins le papier. Le papier choisi pourra être une simple feuille d’imprimante, entière ou coupée en deux. Pour un dessin plus fouillé, un papier plus épais sera mieux adapté.
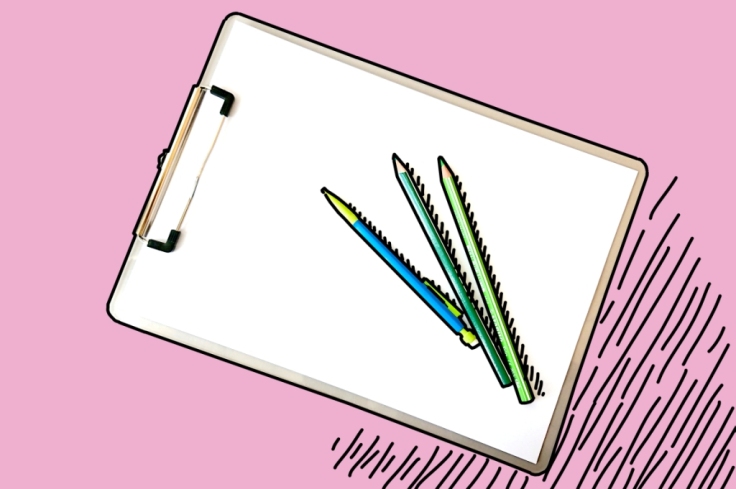
On peut compléter ce starter pack par une règle de 30cm (pour la technique de la mise au carreau), des feutres de différentes tailles et des crayons de couleur, du fusain et des pastels (une laque fixative est la bienvenue)… A vous d’imaginer votre projet !
On se retrouve la semaine prochaine pour un article « trucs et astuces »
avec des tutos et les conseils de la Fabrique Toi-Même 😉
Pour aller plus loin
- Dessiner au musée : le premier article que nous avons consacré au dessin et qui dresse un panorama des offres existantes
- J’apprends à dessiner, Philippe Legendre, Fleurus, que je recommande vivement (au contraire, fuyez Le livre pour dessiner à tout âge des éditions Simplissime, pas du tout facile d’accès)
- La reco lecture de La Fabrique Toi-Même : Carnets de dessins – Une pratique des arts plastiques et visuels à l’école, Sylviane Lugand & Danièle Margalejo, Magnard
